— Retour
Automne 2017 – Numéro 65
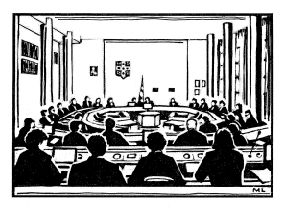
Conseil universitaire du 7 novembre 2017
Un échange de vues sur les Avis de deux Commissions institutionnelles
Le vice-recteur Beauregard préside la discussion
À la demande de la rectrice Sophie D’Amours, le vice-recteur Robert Beauregard (Exécutif, études et affaires étudiantes) préside la discussion simultanée sur l’Avis de la Commission des études concernant l’avenir de la formation et celui de la Commission de la recherche à propos de la recherche et de la formation à la recherche à l’Université Laval, documents qui ont été présentés aux membres, le 7 novembre 2017. Dès le début, la professeure Florence Piron (Lettres et sciences humaines) rappelle que « la société, c’est plus que les Ordres professionnels et les entreprises » pour se réjouir de voir que les Avis font référence à l’importance de la formation citoyenne. Du coup, elle souhaite que les facultés du secteur des sciences puissent être amenées à « profiter de la compétence des facultés de sciences humaines et sociales » précisément dans la perspective de la formation citoyenne dont la finalité est de comprendre le monde dans lequel on vit.
Le professeur André Potvin, directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS), souligne d’abord que c’est la mission de l’Institut de répondre à cette approche de manière interdisciplinaire, particulièrement dans le domaine du développement durable. Puis, il insiste sur le fait que le moyen à utiliser pour susciter une plus grande fierté chez les étudiant.e.s de l’Université, c’est de créer concrètement des projets expérimentaux qui doivent être utiles à la société. À la suite de cette intervention, le vice-recteur Beauregard propose de réfléchir aux moyens pour que « dans cinq ans, ceux-ci soient encore plus fiers de leur université ». Le professeur François Laviolette (Sciences et génie) saisit l’occasion pour expliquer qu’il y a, à son avis, deux silos qui conditionnent la vie externe et interne de l’Université. Le premier concerne ses relations avec la région de Québec. Le second a trait aux relations entre ses unités administratives. Il déplore que l’Université ne soit pas assez intégrée au milieu de Québec et demande qu’on approfondisse cette question. Par ailleurs, il s’étonne de voir comment on ignore sur le campus « les choses extraordinaires qui s’y font ». Il propose, sans ambages, de « faire une cartographie de ce qu’on fait à l’Université Laval. », document qui pourrait être distribuée à ses chercheur.e.s. Le vice-recteur André Darveau (Administration) intervient alors en souhaitant avoir des opinions concernant le défi que pose l’accompagnement de l’étudiant.e dans la personnalisation de son parcours universitaire.
La professeure Nicole Lacasse, directrice générale de la formation continue, apprécie la cohérence existante entre le contenu des deux Avis présentés. Elle n’a cependant pas vu dans ces rapports de considérations sur un enjeu qu’elle estime important, soit celui de la langue française en sous-entendant qu’elle est concurrencée, comme chacun sait, par la langue anglaise dans le monde scientifique et universitaire. Elle suggère d’étudier la question dans le contexte de l’inscription des étudiants étrangers ainsi que de gestes posés par des universités françaises à ce sujet. Elle espère que la préoccupation de la formation continue exprimée dans les Avis aura des suites dans l’organisation et le développement futurs de la formation universitaire parce, actuellement, elle considère que celle-ci est « la cinquième roue du carrosse ». Quant à la nouvelle présidente de la Commission des études, la professeure Marie Audette, en référant à une proposition de création de la fonction de chercheur-médiateur dans l’Avis de la Commission de la recherche, elle pense que les diplômé.e.s de l’Université Laval pourraient être aussi mis à contribution pour la tâche de médiation entre la recherche et l’enseignement ainsi qu’entre la recherche et le milieu social.
Le professeur Louis Bélanger, directeur de l’Institut québécois des hautes études internationales, croit que le souci de l’interdisciplinarité débouche sur le questionnement de la raison d’être de l’existence des disciplines. « On est rendu à une époque où on devrait s’interroger sur la pérennité d’une discipline », estime-t-il. Il se demande pourquoi on évalue les programmes et qu’on n’évalue jamais la pertinence de l’existence des disciplines. « Il y a beaucoup d’obstacles à l’interdisciplinarité qui proviennent de l’incapacité à repenser la configuration des disciplines », conclut-il.
EN BREF
- Mme Hélène Richard, Ombudsman, a remis son rapport 2016-2017. Elle propose que la Direction de l’université procède à une consultation auprès des membres de la communauté universitaire en vue de l’élaboration d’un code d’éthique pour encadrer les activités d’enseignement, de recherche et de création;
- Un Comité de réflexion sur la gouvernance du Conseil universitaire a été créé. Les membres élus sont les suivants : Alain Faucher, François Laviolette, Samuel Rouette-Fiset, Lyne Bouchard, Sylvain Lavoie, Carole Carbonneau, Michel Gendron, Nadia Tawbi, Marie Audette, François Gélineau, Rachel Lépine, Josée Bastien, Ronald Beaubrun;
- La Commission des affaires étudiantes a reçu le mandat de rédiger un avis sur l’expérience étudiante, ses limites et son importance durant ses activités de 2017-2018;
- L’évaluation périodique du Centre d’étude de la forêt (CEF-ULaval), a été effectuée. Son statut institutionnel de centre reconnu a été renouvelé pour les cinq prochaines années.
Jacques Rivet, cc
Entretien avec le professeur Lionel Meney
Une recherche universitaire qui se poursuit à la retraite sans rupture.
« Je ne dis pas comment bien dire. Je donne les éléments de connaissance linguistique qui permettent au locuteur de faire des choix éclairés »

Le professeur Lionel Meney, à la retraite depuis 2004, vient de publier un troisième ouvrage majeur en linguistique, Le français québécois entre réalité et idéologie : un autre regard sur la langue*, après avoir rédigé un Dictionnaire québécois-français (1999) et Main basse sur la langue (2010). Nous nous sommes entretenu avec lui, particulièrement pour recueillir son témoignage en tant qu’universitaire toujours actif, comme en donne la preuve cette récente publication.
JR : Cet ouvrage ne vient pas exclusivement de la période de votre retraite. Il est le prolongement d’une longue carrière d’enseignement et de recherches universitaires?
LM : Tout à fait. En un sens, il vient du premier jour de mon arrivée au Québec, le 3 septembre 1969. J’avais une formation de linguiste dans le domaine des études slaves. N’ayant pas la possibilité d’enseigner la langue russe, je me suis réorienté du côté de la langue française. C’était logique. J’étais linguiste, très intéressé par tous les problèmes de langue et, en plus, arrivant ici, je découvrais les nombreuses différences linguistiques entre la France et le Québec. Différences encore plus grandes à l’époque que maintenant. En fait, tout est lié chez moi: mon histoire personnelle, mon enseignement et ma recherche. Je me suis totalement intégré à la vie québécoise, si bien que, tous les jours et toutes les minutes, mon oreille m’incitait – et m’incite encore – à chercher quelle est l’origine de ces différences. Ce livre que vous avez en main, lequel m’a demandé six ans de travail, est la continuité exacte de ce que j’ai découvert le premier jour de mon arrivée ici. Mon objectif, dans cet ouvrage comme dans mes livres précédents, par exemple mon Dictionnaire québécois français, n’est pas de dire aux Québécois comment « bien parler », mais de dire : « Quand au Québec on dit ceci, en Europe francophone on dit cela. » Je suis à la fois très européen et très québécois.
JR : Vous utilisez la méthode de la comparaison dans votre ouvrage. C’est une approche scientifique qui permet d’exercer son jugement pour faire des choix?

LM : C’est exact. Je ne dis pas comment « bien dire ». Je donne les éléments d’information linguistique qui permettent au locuteur de faire des choix éclairés. C’est à la fois l’enseignant, le chercheur et le citoyen en moi qui agissent comme une sorte de porte-voix des locuteurs francophones, si je puis dire. Si l’on regarde mes trois ouvrages, on constate que c’est toujours la comparaison qui guide ma réflexion. À ce propos, pour ce dernier livre, la base de textes Eureka m’a permis de le faire dans des conditions exceptionnelles d’accessibilité aux faits de langue de la presse francophone québécoise et française.
JR : En quoi votre retraite-a-t-elle favorisé votre travail de rédaction consécutif à vos recherches sur le français québécois?
LM : La retraite m’a donné du temps. Ma tâche d’enseignement dans les programmes de traduction était très chronophage parce que je me suis toujours adressé à de grands groupes et je croulais sous les corrections. Sans compter les tâches administratives, les comités, les réunions… La nécessité de rédiger des demandes de subvention suivies de rapports de recherches – partiels ou définitifs – est une activité accaparante qui ne favorise pas le travail de réflexion et de synthèse nécessaire à une certaine étape de la recherche. Alors, au moment de ma prise de retraite, je n’ai jamais pensé que c’était la fin de mes recherches. Au contraire, j’avais enfin assez de temps libre pour m’y consacrer entièrement. Dans mon domaine, la recherche demande beaucoup de réflexion. J’avais accumulé beaucoup de données et pas mal réfléchi aux questions qui m’intéressent, à savoir la variation linguistique entre le français d’ici et celui de France, la norme linguistique, la qualité de la langue, la question des anglicismes, les idéologies linguistiques… Enfin j’avais du temps pour la maturation. J’avais la possibilité de continuer ce que j’avais fait et même de dépasser ce que j’avais déjà réalisé.
JR : Vous avez bien dit « dépasser » ?
LM : Oui, car dans mes recherches, il y a une continuité et une gradation, des étapes. La première, ce fut l’appropriation et la description du français québécois, comme en témoigne mon Dictionnaire français-québécois, premier essai dans la Francophonie d’un dictionnaire non pas bilingue mais bivariétal, qui est un inventaire des particularismes du français québécois au regard du français de référence. Dès mon arrivée en 1969, à l’époque des grands débats d’affirmation du français, j’ai commencé à m’intéresser aux idéologies linguistiques. Dans une deuxième étape, ma réflexion a donc porté tout naturellement sur la norme et la qualité de la langue – c’était une question cruciale pour un enseignant de français dans les programmes de traduction, comme pour tout enseignant d’ailleurs. Mon livre Main basse sur la langue présente tout le contexte historico-géopolitique de la question et procède à une analyse critique des principales productions lexicographiques québécoises. Dans une troisième étape – c’est l’objet du Français québécois entre réalité et idéologie – je me suis fixé pour tâche de décrire objectivement les caractéristiques et le fonctionnement du marché linguistique québécois. A la suite de quoi, j’ai procédé à une analyse des diverses idéologies linguistiques ayant cours au Québec afin de montrer la distance existant entre cette réalité et les diverses idéologies qu’elle a suscitées.
JR : Précisément, ce qui m’intrigue dans cet ouvrage, c’est la notion de marché. Pourquoi parlez-vous de marché?
LM : C’est une notion qui m’a été inspirée par le sociologue français Pierre Bourdieu (1930–2002). C’est une métaphore qui indique que tout locuteur, pour s’exprimer, doit choisir les produits linguistiques (les mots et leurs différentes valeurs sociales, car à chaque mot, à chaque structure grammaticale est attachée une valeur) sur le marché linguistique de la société dans laquelle il vit. Or, le marché linguistique québécois est singulier et complexe. C’est ce qui rend plus difficile le choix d’une norme admise par tous. Il se caractérise par une concurrence non seulement entre deux langues, le français et l’anglais, mais aussi entre deux variétés d’une même langue, un français vernaculaire québécois et un français international. Je me suis posé la question de savoir s’il y avait une norme linguistique proprement québécoise, différente de la norme du français international, ou bien si la question était plus complexe qu’on ne le dit. Par une étude précise de centaines d’exemples concrets, j’ai montré qu’en réalité, dans la société québécoise, il n’y a pas une seule norme, mais deux, qui sont en concurrence, une norme nationale et une norme internationale. Dans certains cas, la norme nationale est plus souvent utilisée que la norme internationale (on dit bleuet plutôt que myrtille). Dans d’autres cas, la norme internationale l’emporte sur la norme nationale (on ne dit plus guère que robinet, champlure ayant presque disparu). Dans de très nombreux cas, les deux normes se font une concurrence serrée (on dit, dans des proportions presque égales, tomber en amour et tomber amoureux, fin de semaine et week-end). Dans une perspective historique, sur une période de quelques décennies depuis le début de la Révolution tranquille, on note une progression remarquable de la norme internationale. Cela signifie que le marché linguistique québécois est de plus en plus intégré et semblable au marché francophone européen et que les produits internationaux y sont de plus en plus utilisés.
JR : Un dernier sujet sur lequel je voudrais avoir votre avis : la partie « enseignement » de votre carrière universitaire. Quelle place y a-t-elle prise par rapport à vos recherches?
LM : Je vous dirai franchement que, lorsque j’étais en activité, j’aimais mieux enseigner que faire de la recherche, pour les raisons que j’ai évoquées plus haut. Ce que j’aimais le plus dans l’enseignement, c’était préparer des cours, trouver une manière simple d’expliquer une question complexe, répondre aux nombreuses interrogations de mes étudiants, surtout leur inculquer une méthode de travail, l’amour de la rigueur. Je crois tenir de mes parents, eux-mêmes enseignants, une sorte de fibre pédagogique. De fait, par leurs questions, mes étudiants me ramenaient sans cesse à mes recherches, qui étaient en symbiose avec mon enseignement. Finalement, je leur dois beaucoup.
JR : En expliquant les choses selon la manière explicitée dans votre dernier ouvrage, avez-vous pensé à vos étudiants, particulièrement du point de vue des objections qu’ils auraient pu vous servir?
LM : Assurément, de façon constante. Il m’arrivait d’avoir à argumenter avec tel ou tel de mes étudiants, qui n’était pas d’accord avec moi. Les questions de langue sont délicates. Elles touchent à l’identité. Mais je voudrais évoquer le sujet de l’attitude des étudiants sous un angle un peu différent. En général, ceux-ci sont surtout préoccupés – de façon tout à fait légitime d’ailleurs – par l’obtention de leur diplôme, synonyme d’emploi à la clé. C’était particulièrement le cas dans les programmes de formation de traducteurs professionnels où j’enseignais. J’étais parfois un peu déçu par leurs préoccupations étroitement utilitaires. Beaucoup voulaient simplement savoir si l’emploi de tel ou tel mot était correct ou fautif, sans vouloir examiner tous les aspects, toute la complexité de la question. Ils voulaient entendre une réponse binaire : oui ou non? Je m’attachais à leur montrer que les choix linguistiques ne se résument pas à des réponses de QCM. J’ai toujours essayé de leur montrer qu’il fallait d’abord et avant tout exercer son jugement. Et que pour ce faire, il fallait acquérir une certaine culture, lire beaucoup et pas uniquement la même chose, élargir son horizon à tout le monde qui nous entoure. C’est essentiellement ce message que je leur répétais sans cesse. En repensant à mes trois livres, j’ai également essayé d’expliquer au public lecteur que la problématique de la langue au Québec est plus complexe qu’il ne le croit, en lui donnant des éléments de connaissance pour qu’il puisse en juger en toute connaissance de cause. L’enseignement, la recherche et ma position personnelle comme Québécois concernant les problèmes de la langue française au Québec, tout ça, je le rappelle, est lié chez-moi.
JR : Si je vous ai bien compris, la possibilité que vous avez eue d’enseigner vous a permis de réfléchir à vos recherches…
LM : Étant chargé d’enseigner le français et la traduction dans des programmes de formation de traducteurs en contexte québécois, j’étais constamment confronté au problème de la norme et de la qualité de la langue. Cette situation m’a conduit tout naturellement à devoir creuser la question, pour moi d’abord, pour mes étudiants ensuite, et pour les lecteurs enfin qui veulent bien s’intéresser à mes publications. Ma matière d’enseignement est à l’origine de mes interrogations et donc de mes recherches. Cela est apparu dès le début de mon enseignement et ne m’a pas quitté depuis. Même à la retraite…
* Meney, Lionel, Le français québécois entre réalité et idéologie : un autre regard sur la langue, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2017, 635p.
Jacques Rivet, cc
